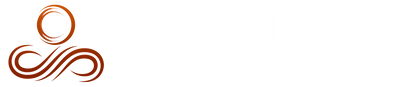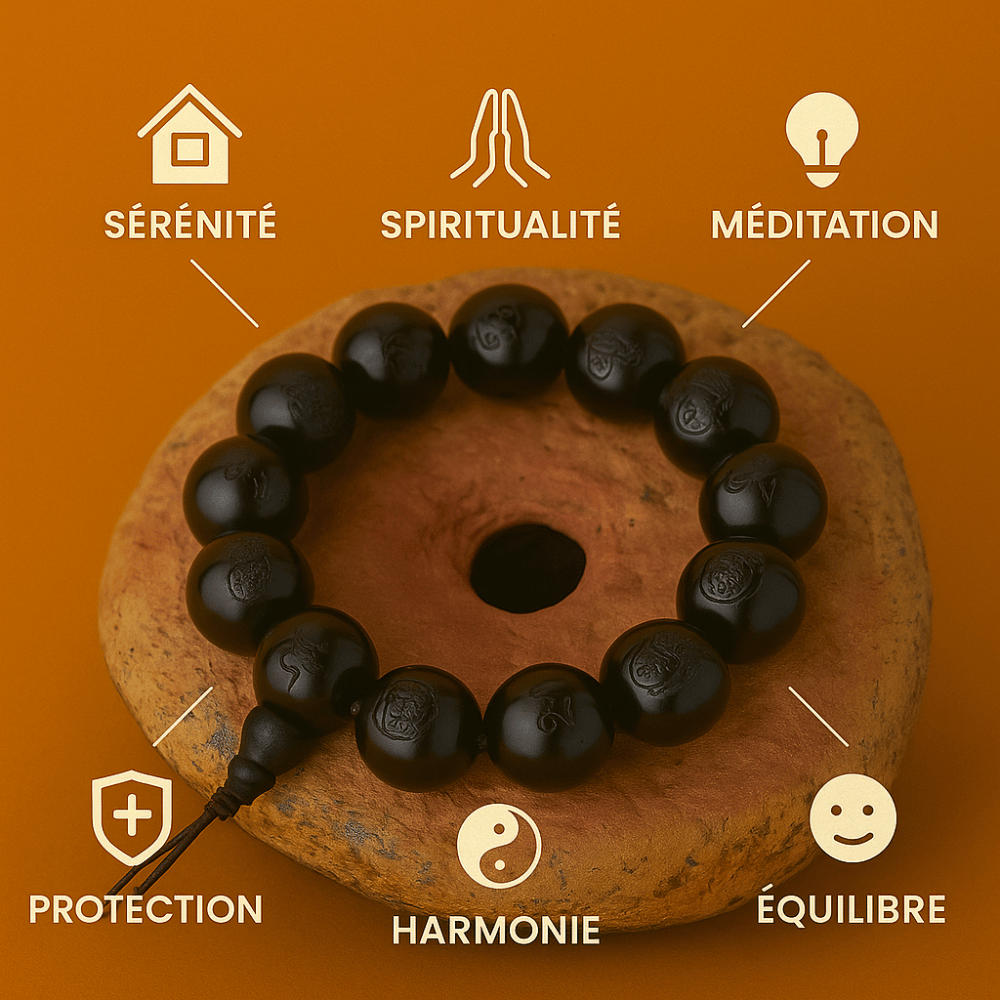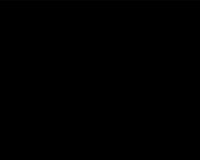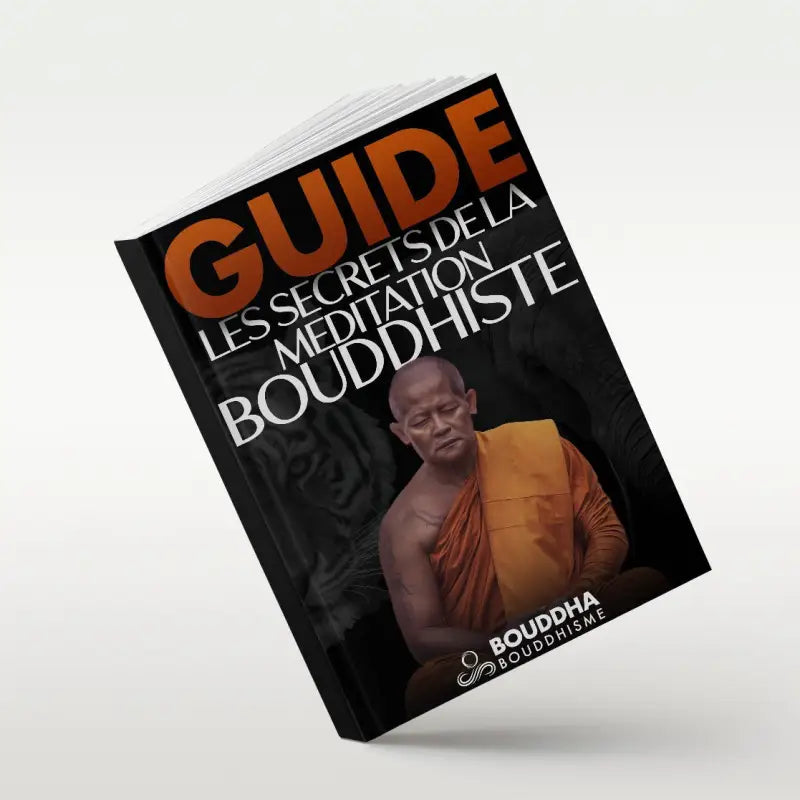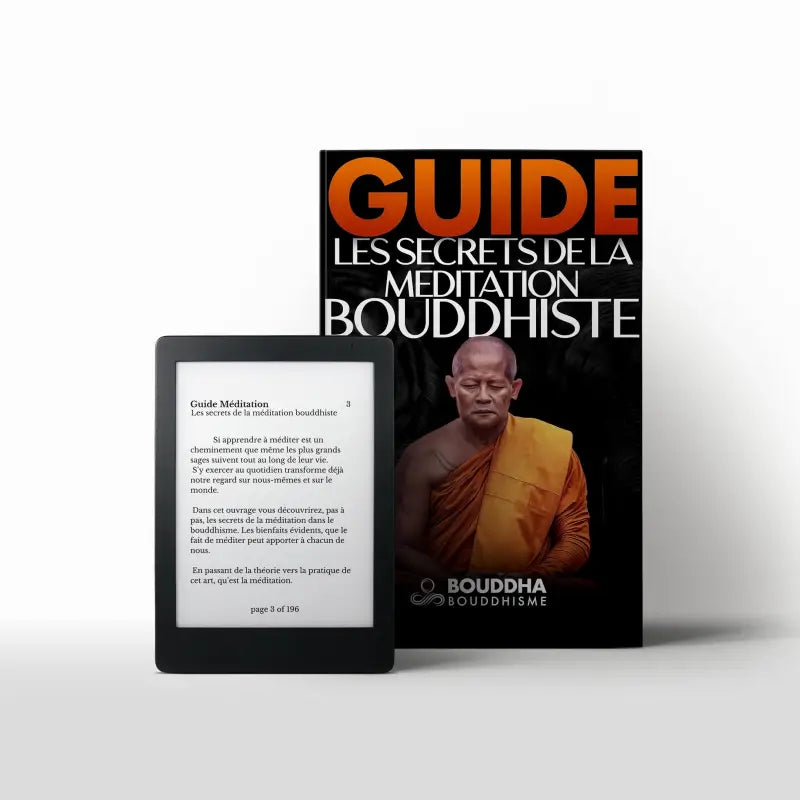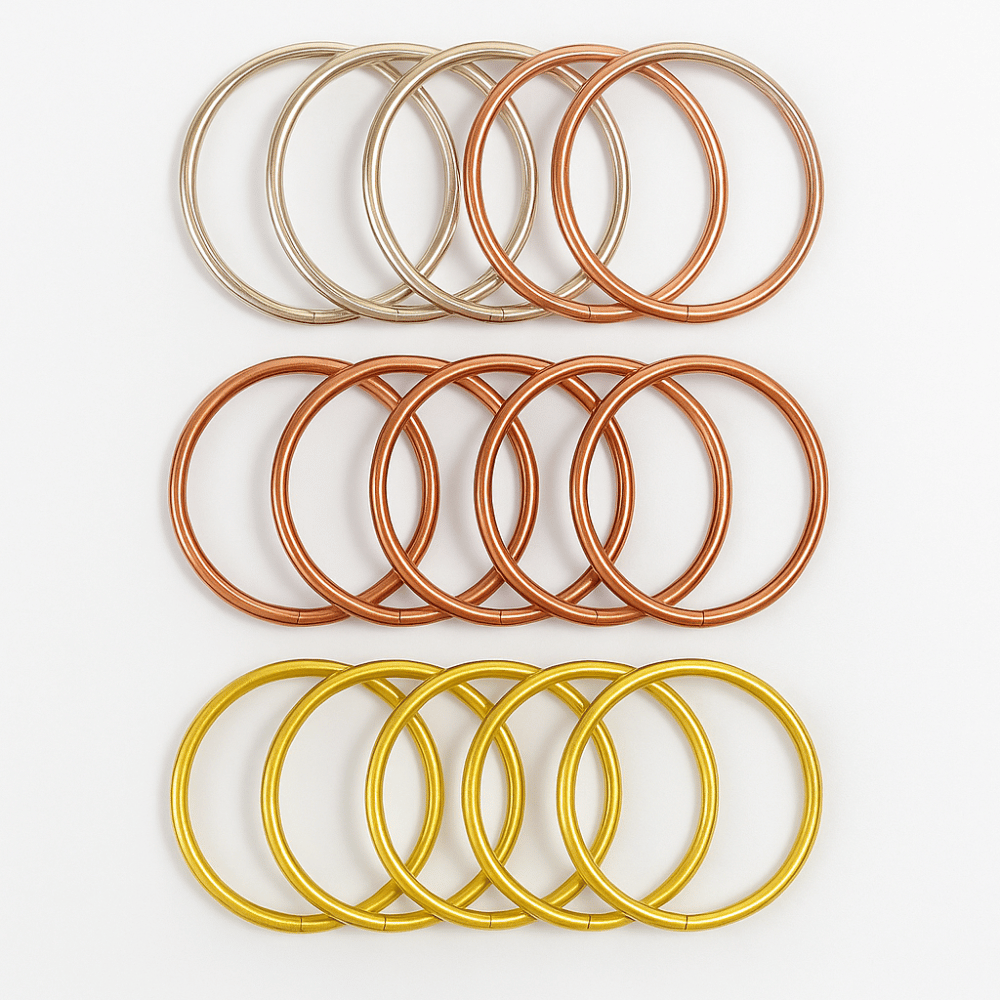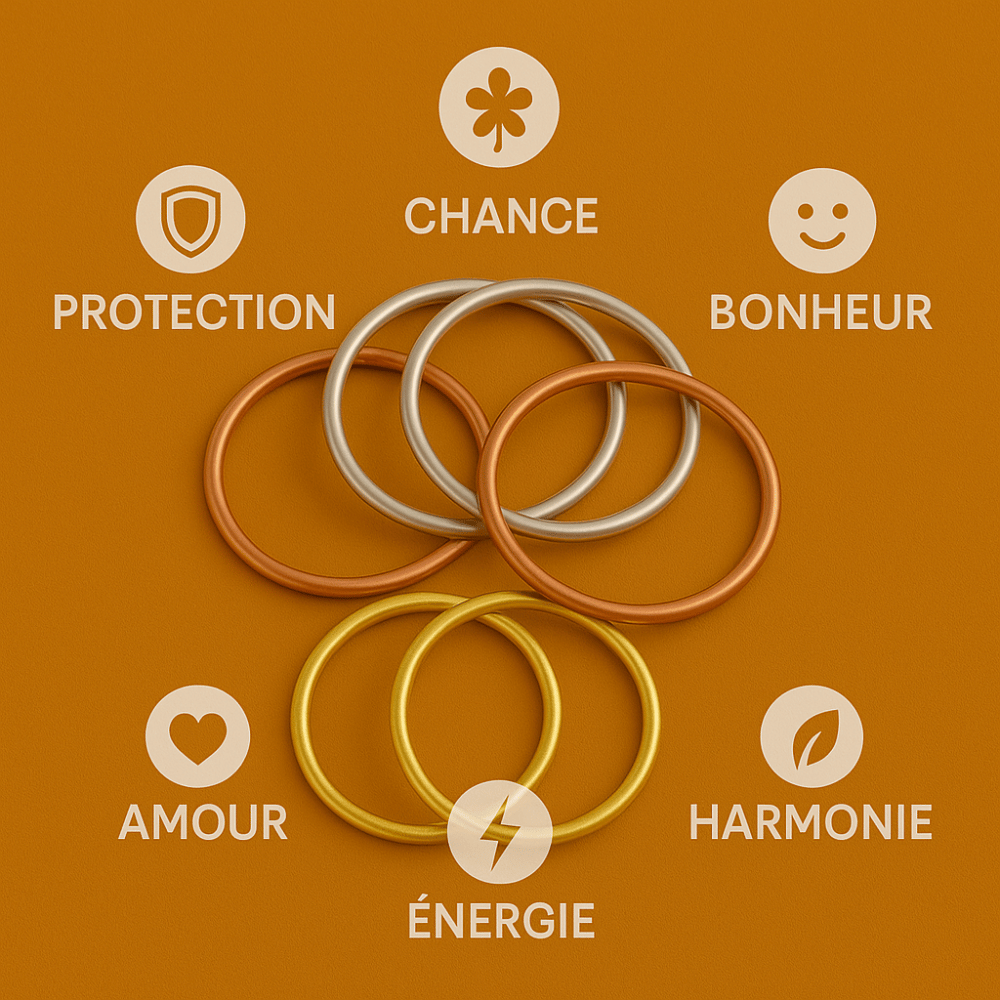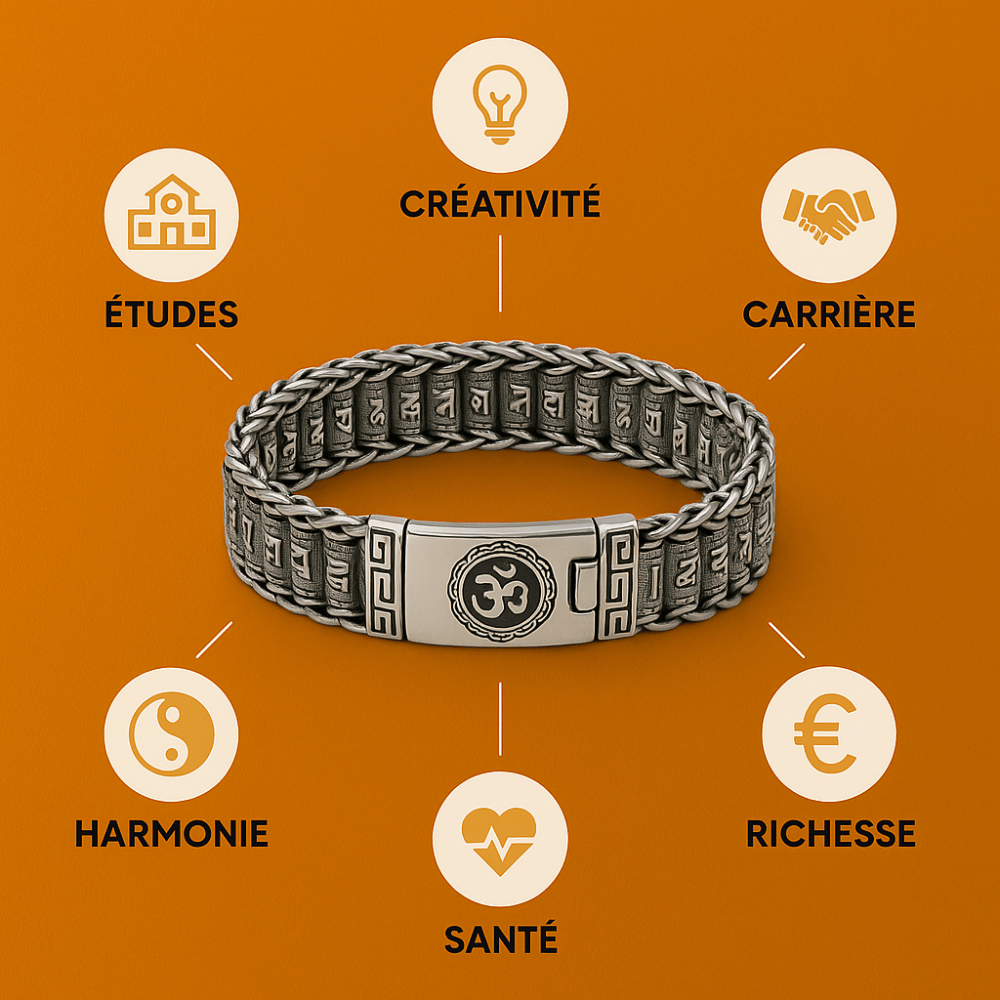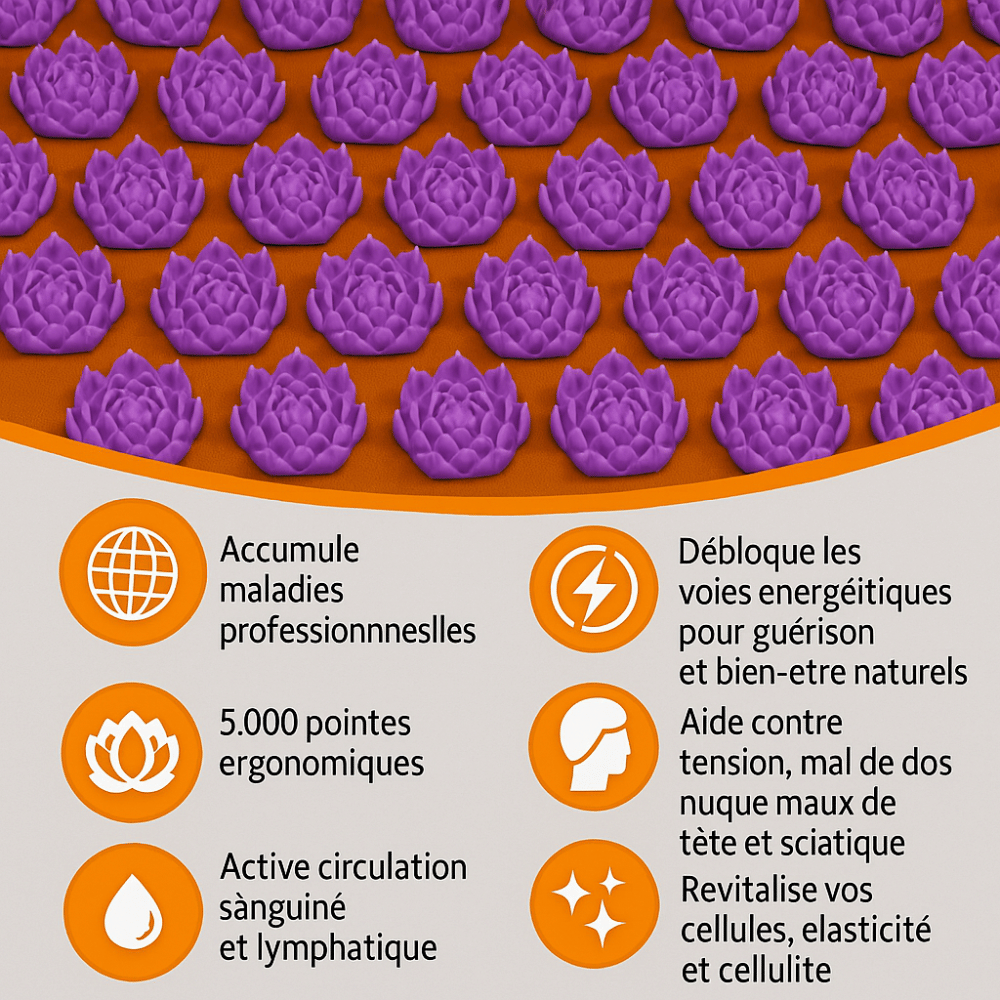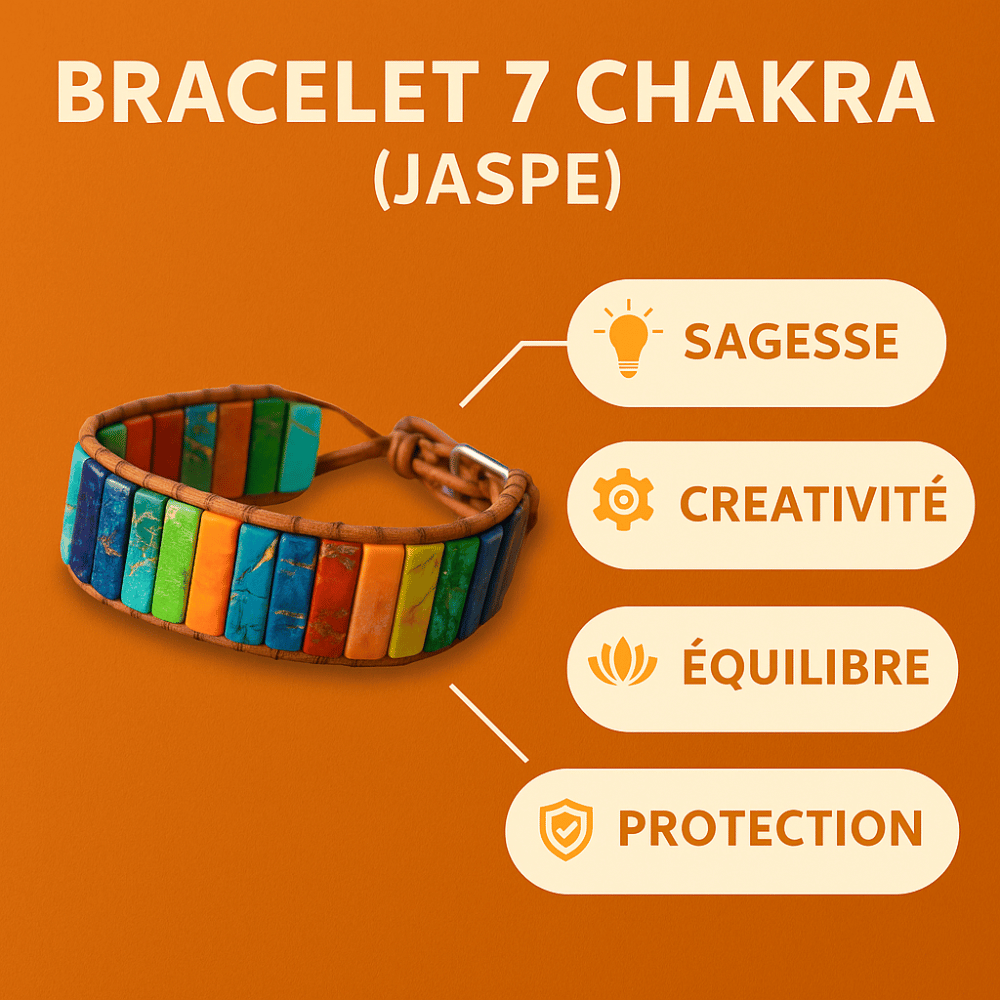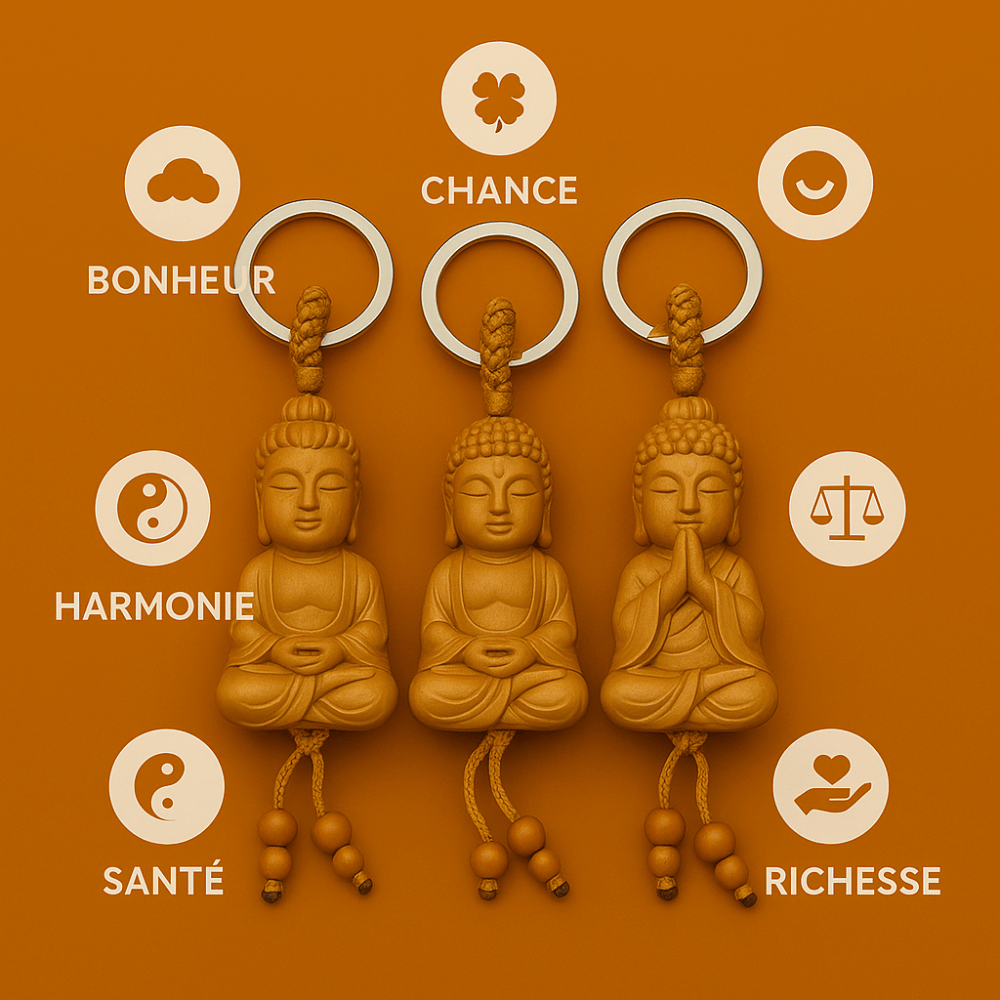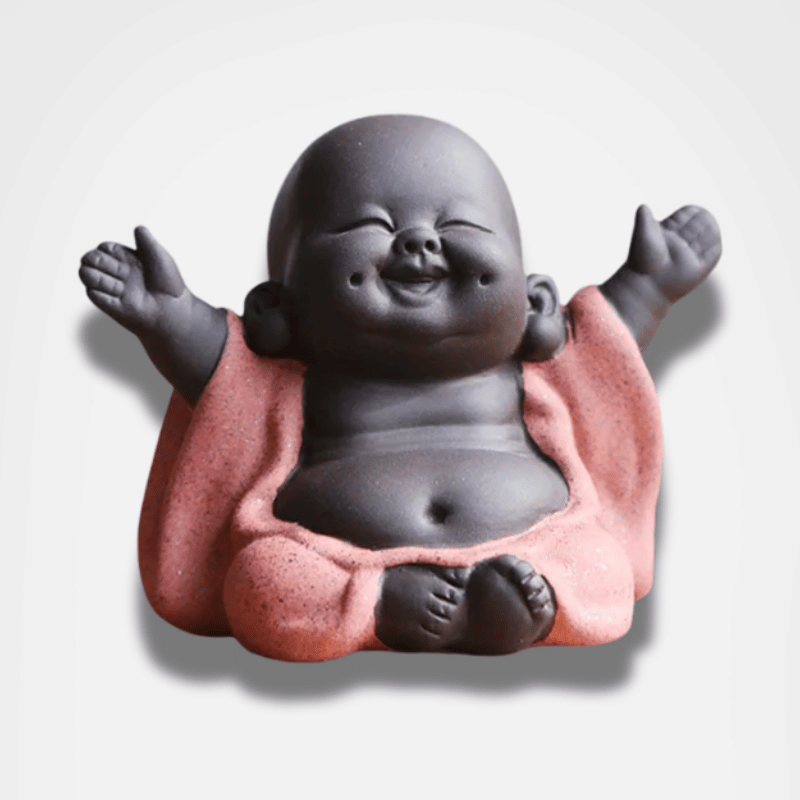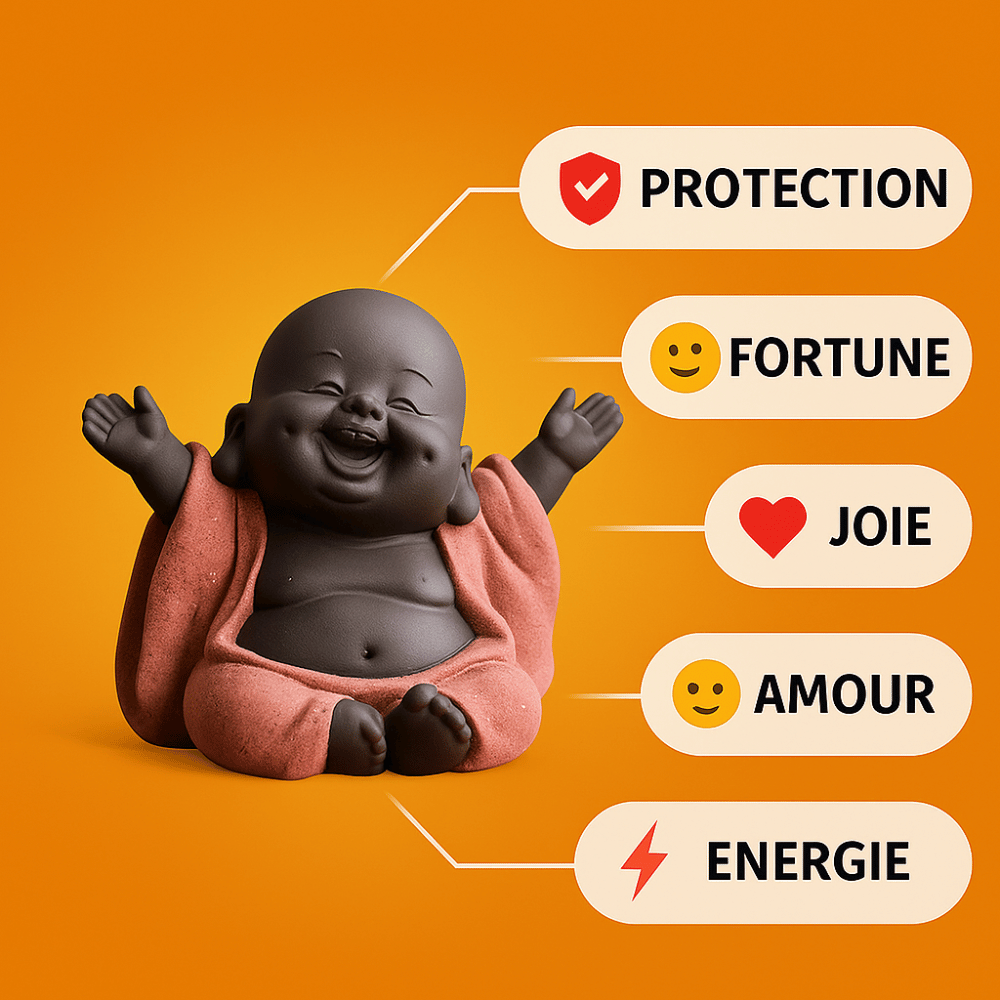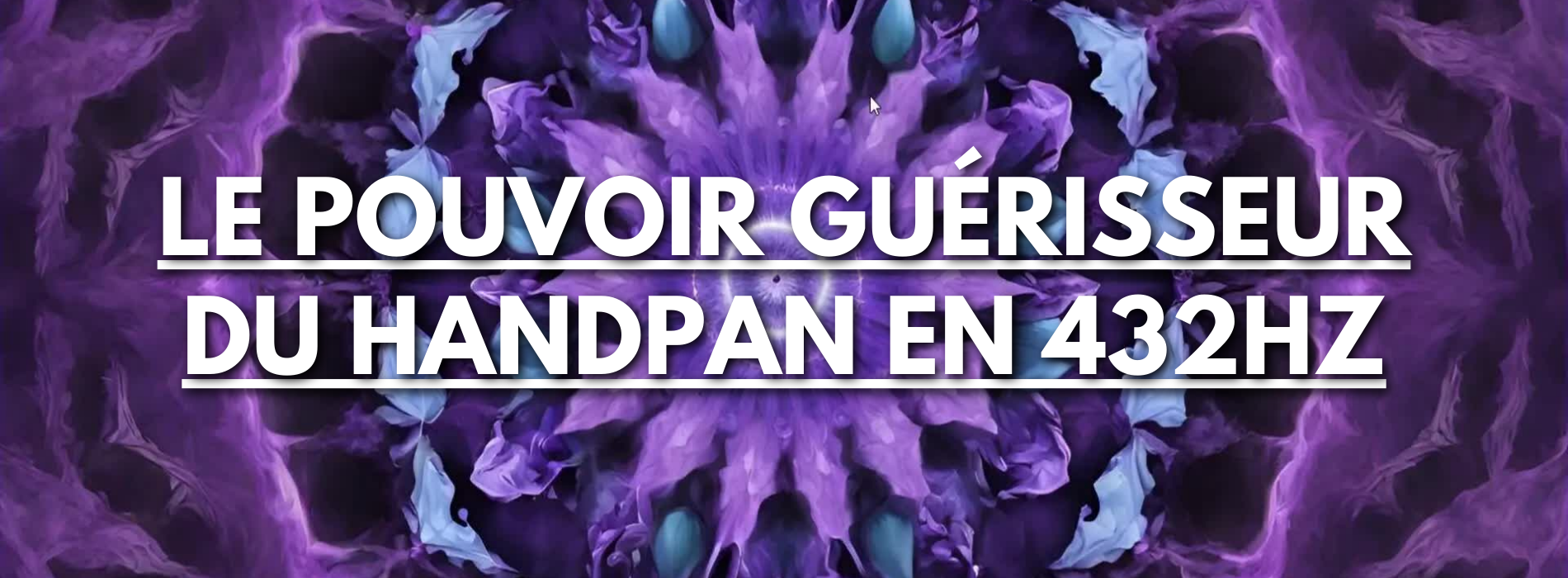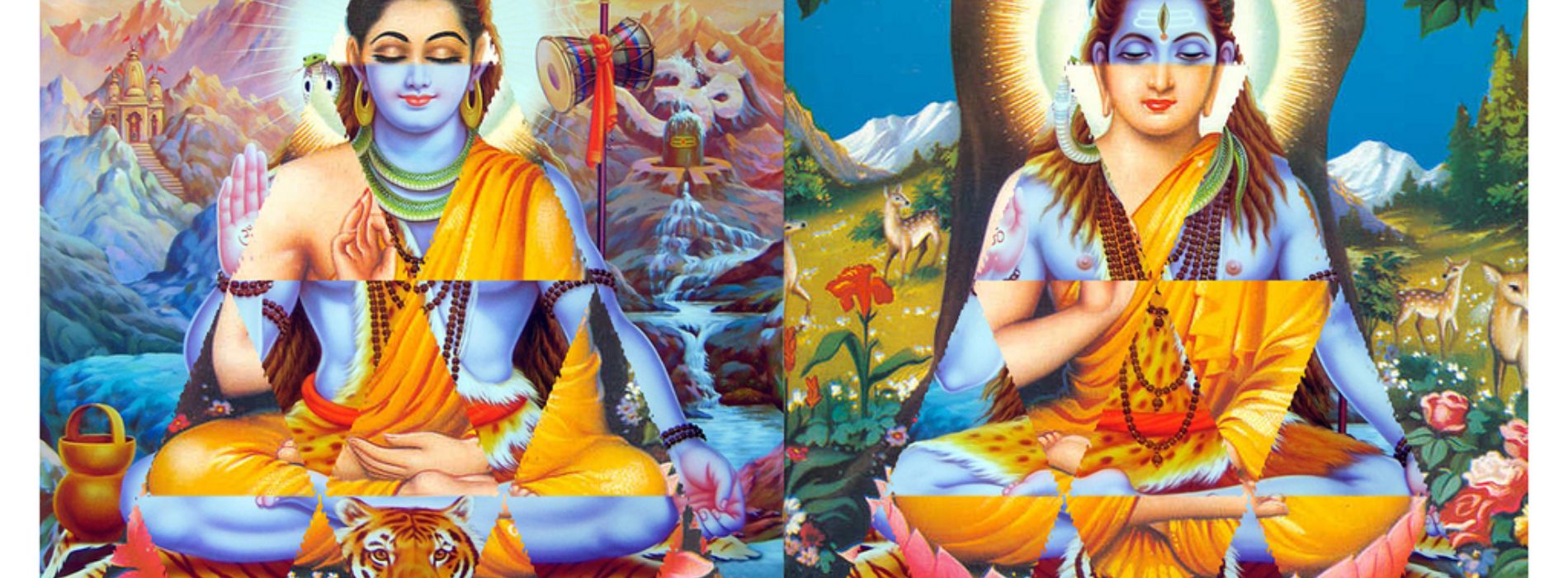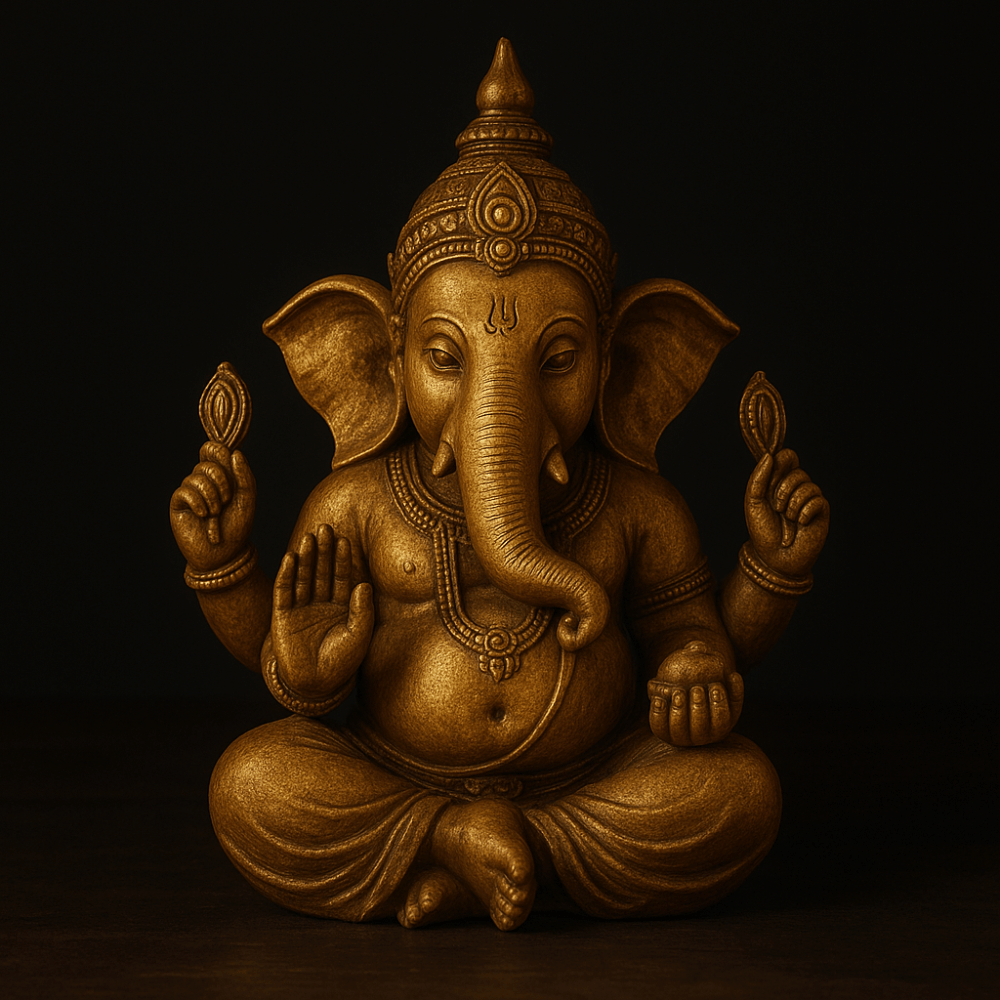En Chine, le bouddhisme se développe depuis plus de vingt ans. La majorité de la population chinoise est dévouée à cette spiritualité. Mais quels sont les préceptes du bouddhisme ?
Comment le bouddhisme a-t-il convaincu les Chinois ?
Dates historiques du bouddhisme en Chine
Le bouddhisme se répand en Chine depuis des décennies et a évolué depuis les années 1949. Pendant plusieurs années, la religion bouddhiste a été confrontée à plusieurs défis, dont le plus grave était le manque de ressources financières. Ce n'est que quelques années plus tard, dans les années 1980, que des pays comme Taiwan, Hong Kong, la Corée, le Japon et l'Asie du Sud-Est ont contribué à la reconstruction de monastères et de temples pour raviver le bouddhisme chinois.
Les Chinois laïcs s'intéressent de nouveau au bouddhisme et sont revenus aux pratiques et rituels bouddhistes au milieu des années 1990. Selon les résultats du recensement des laïcs chinois, environ 20% des adultes s'identifient comme bouddhistes. Bien que ce pourcentage soit faible, il ne comprend que les personnes interrogées. En effet, la conversion bouddhiste en Chine n'est pas assez formelle. De plus, le bouddhisme mahayana compte actuellement plus de cent millions de laïcs. Le nombre d'employés a considérablement augmenté depuis 2003.
Entrée du bouddhisme en Chine
Bouddha a toujours été perçu comme un personnage unique et en or. Au premier siècle de notre ère, l'empereur Ming de la dynastie Han demanda aux missionnaires bouddhistes arrivant en Chine de rapporter des textes bouddhistes. C'est pourquoi l'expansion du bouddhisme dans le pays est spontanée et progressive et offre une nouvelle vision de la vie par le salut. La religion a été très vite adoptée par les Chinois.
C'est ainsi qu'au IIe siècle de la même période, les premiers sanctuaires bouddhistes furent établis et documentés. Les moines et les nonnes des sanctuaires étaient originaires d'Asie centrale. Deux siècles plus tard, à partir du IVe siècle, le bouddhisme est devenu l'institution religieuse la plus puissante de Chine.
Essor du bouddhisme en Chine
La montée en puissance de cette religion est soulignée depuis plusieurs décennies en Chine. L'histoire du bouddhisme chinois est incroyable. A partir du 5ème siècle de l'ère Tang, une société de traduction canonique était chargée de traduire des textes bouddhistes en chinois dans les langues d'Asie centrale et indiennes. Ces textes traduits sont encore visibles dans les monastères chinois et sont perçus comme un patrimoine sacré. Cela a conduit à l'ouverture d'écoles de pensée bouddhistes, qui se poursuit encore aujourd'hui.
Le bouddhisme est considéré comme la principale institution monastique et religieuse de la société chinoise. Les moines et les nonnes assurent le partage des valeurs et la diffusion des idées bouddhistes. Cette révolution du bouddhisme chinois fait l'objet d'un tourisme religieux en Chine. Par conséquent, la popularité de la religion va au-delà d'autres religions telles que le taoïsme et le christianisme.
Généralités sur Bouddha et le Bouddhisme
Guatama Siddhartha, a vécu plusieurs décennies avant notre ère. Connu sous le nom de Bouddha, il sert de référence dans la spiritualité bouddhiste. Après son illumination, il sert de point de repère et d'ancrage aux bouddhistes. Etant l'Illuminé, il enseigna les vérités qu'il découvrit au cours de sa profonde méditation sous la pagode des fuigiers. Au cours des trente dernières années, il y a eu un nombre croissant d'adeptes et de pratiquants bouddhistes. Le bouddhisme est une spiritualité basée sur plusieurs principes tels que la vie, le salut, la loi, la réalité et le changement.
Chaque principe a un objectif, un sens et une signification. Néanmoins, tous ces quatre préceptes forment l'univers du bouddhisme. Depuis l'époque de Bouddha, il y a 2500 ans, le bouddhisme s'est répandu dans le monde entier et cette diffusion est même devenue sans frontières.
Nirvana dans le bouddhisme
Le nirvana est l'objectif principal des bouddhistes. La réalisation d'une telle vérité est leur raison d'être et leur inspiration. Le Nirvana est défini comme l'état de Bouddha quand il est éveillé, c'est-à-dire, quand il a été illuminé sous l'arbre de la bodhi. Il est le seul être de son temps à avoir subi le cycle du samsara, car au moment de sa mort, il a cessé de naître et de renaître. C'est pour cela qu'on dit qu'il a atteint le nirvana avant de mourir. Il est la preuve irréfutable de la possibilité du nirvana. Selon son enseignement, se connaître soi-même est le principal moyen par lequel l'homme peut y parvenir.
Puis il y a l'acceptation de soi et l'appréhension de ses propres souffrances quelle qu'en soit la nature. Par conséquent, connaître la causalité de notre souffrance est aussi un impératif dans le nirvana. Il est bon de rappeler que les attachements et les désirs sont généralement à l'origine de nos souffrances. Pour tenir compte de ce stress contextuel, il nous serait plus facile de nous débarrasser de l'anxiété, de l'anxiété et de toutes sortes de problèmes de ce genre.
Les principaux courants du bouddhisme
La diffusion du bouddhisme et des pratiques liées à cette spiritualité a augmenté au cours des cinquante dernières années. Le bien-être, la sagesse et la paix sont les sources de motivation pour les nouveaux membres et les adeptes. Voici les principaux courants du bouddhisme qui sont encore présents aujourd'hui :
- Theravada : Aussi connu sous le nom de hinayana, cette première catégorie du bouddhisme n'est autre que sa forme traditionnelle. Certains bouddhistes l'appellent « le petit véhicule » parce que les pratiques et les rituels entrepris par des pays comme Ceylan, le Laos, la Birmanie, l'Indonésie, le Cambodge, le Népal et la Thaïlande sont conformes à l'original, c'est-à-dire l'époque du Bouddha.
- Mahayana : cette deuxième catégorie de bouddhisme connue sous le nom de « Le Grand Véhicule » est une fusion des pratiques bouddhistes traditionnelles et du bouddhisme moderne. Elle s'adapte aux différentes cultures et pratiques socioculturelles d'aujourd'hui. Le Mahayana se compose de Vajrayana – pratiques centrées sur les « Dhâranis » ou formules magiques, les « Mudrâs » ou signes magiques et les « Mandâras » ou prières magiques – ; de la Terre Pure – récitation du nom du Bouddha Amithaba et pratiques faites avec le chapelet – ; et de Dhyana –Bouddhisme « Zen » axé sur la méditation–.